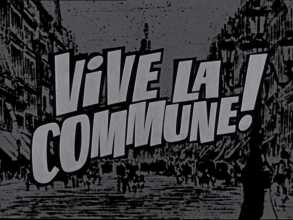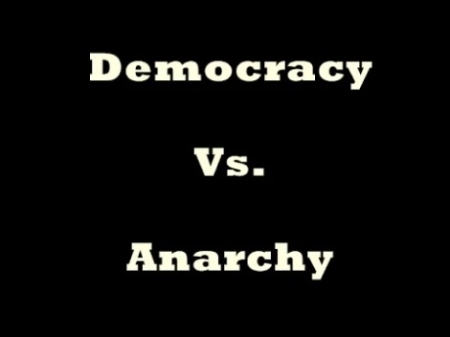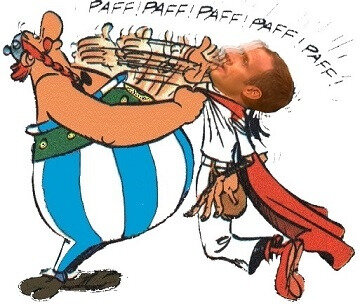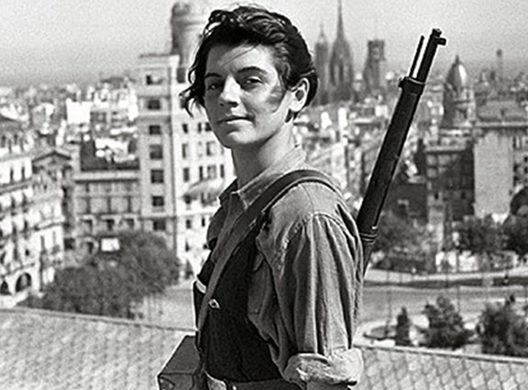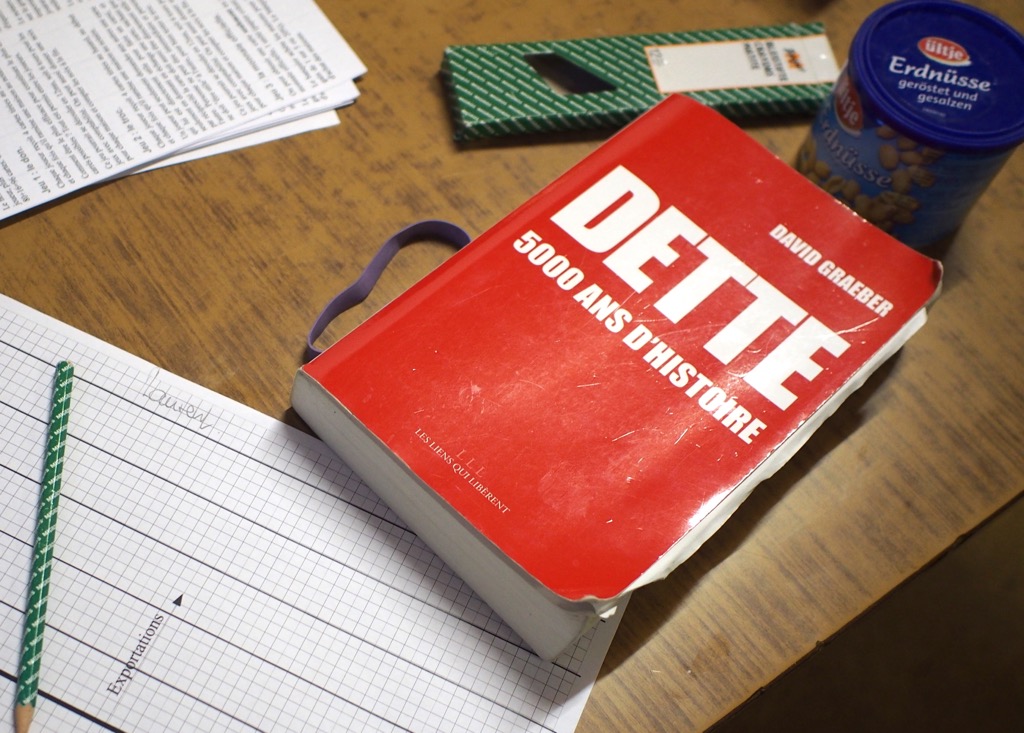David Graeber (1961-2020)
Anthropologue politique anarchiste
“Qu’est-ce que l’État ? C’est le signe achevé de la division dans la société, en tant qu’il est l’organe séparé du pouvoir politique: la société est désormais divisée entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent. La société n’est plus un Nous indivisé, une totalité une, mais un corps morcelé, un être social hétérogène… »
~ Pierre Clastres ~
“Les deux grandes questions incontournables de l’anthropologie politique sont:
1- Qu’est-ce que le pouvoir politique, c’est à dire qu’est-ce que la société ?
2- Comment et pourquoi passe t’on du pouvoir politique non-coercitif au pouvoir politique coercitif, c’est à dire qu’est-ce que l’histoire ?”
~ Pierre Clastres, 1974 ~
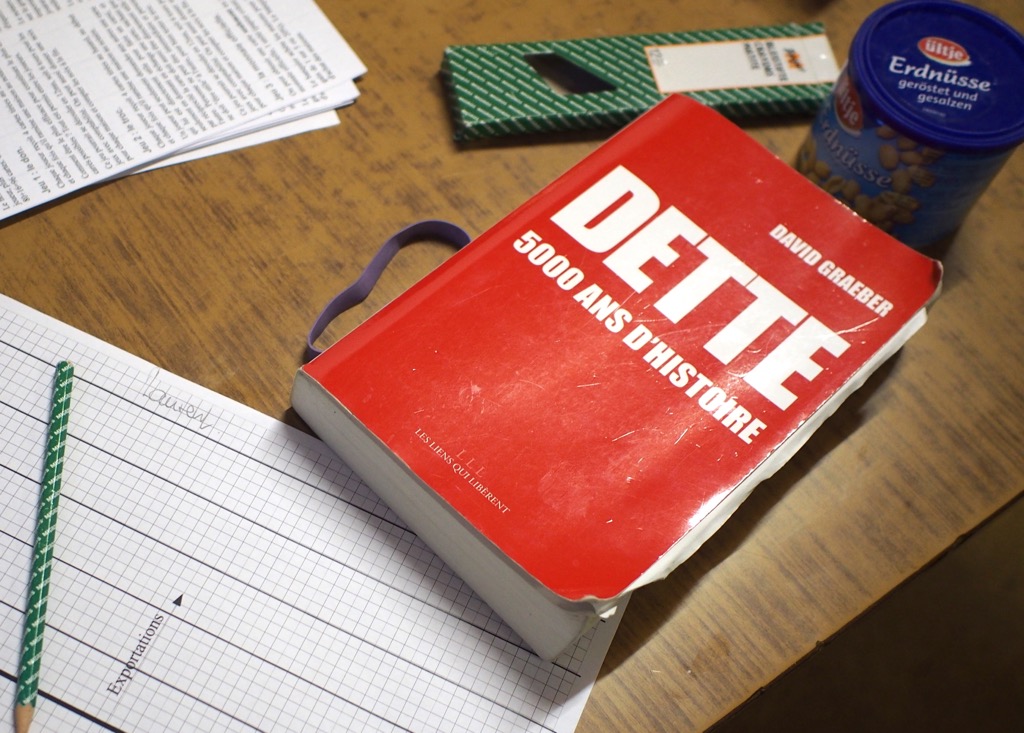
La signification de l’argent
David Graeber
2014
~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~
Février 2023
Je veux parler de l’argent en tant que technologie morale. Une des choses qui m’a fasciné lorsque je travaillais sur mon livre “Dette, les premiers 5000 ans”, c’est la tendance de la logique du marché de coloniser et d’envahir d’autres formes de moralité, même le langage et la religion. Pratiquement toutes les grandes religions du monde sont incroyablement riches dans le langage de la finance, prenez des mots comme rédemption et ceci ne se produit pas seulement avec le christianisme mais quasiment dans toutes.
La moralité a eu la tendance à être traitée comme une affaire de payer ses dette. Ce fut une des raisons qui m’amena dans ce voyage intellectuel si particulier ; je fus fasciné par le pouvoir moral de l’idée de la dette et par sa tendance à tromper toute autre forme de moralité, ainsi les gens purent justifier de choses qu’ils n’auraient jamais osé rêver justifier en d’autres circonstances : la famine et la mort de bébés par exemple sur la simple base causale que “ce pays a emprunté de l’argent…”
L’invasion du langage de la morale par celui de la dette et de l’argent semble être partie d’un autre phénomène, qui est la réduction de toutes les relations sociales à des formes d’échange. Vous trouvez que presque toutes les grandes religions du monde commencent avec le présupposée que la bonne moralité est simplement une question de payer ses dettes. Dans la théologie brahmane par exemple, toutes les formes de moralité sont à la base des formes de dettes. Cela commence avec la dette envers les dieux, qui est une dette de vie, de laquelle on paie des intérêts sous forme de sacrifices et d’offrandes et dont nous payons le principal après notre mort.
Si on y regarde de plus près pourtant, les autres exemples que les brahmanes utilisent complètement subvertissent l’idée que ces obligations morales soient vraiment de la dette. Ils disent que vous avez une dette envers vos parents que vous repaierez en ayant des enfants ; vous avez aussi une dette envers le sage que vous repaierez en apprenant la sagesse et en devenant vous-même un sage. Vous avez aussi une dette envers l’humanité car elle rend votre vie possible, que vous repaierez en étant généreux avec des étrangers. Rien de tout cela ne prend la forme de repayer une dette sous la forme et le sens classiques. En fait, ceci semble impliquer que l’on efface une dette en comprenant que vous devez tout cela à une totalité qui vous inclut et que donc l’idée de dette devient saugrenue. Votre dette envers les dieux n’est qu’une dette envers l’univers. Vous ne pouvez pas repayer une dette à l’univers parce que cela impliquerait que vous et l’univers êtes des associés égaux dans une entreprise vous liant. C’est l’absurdité de cela qui annule l’idée de la dette. Dans la tradition judéo-chrétienne, il y a cette notion similaire de dette primordiale, mais il en résulte que ce qui est sacré n’est pas de repayer sa dette, mais l’annulation des dettes : la rédemption. C’est presque comme si tout le monde devait commencer en disant : “la moralité est de payer ses dettes”, puis ils s’en écartent.
La question est : Pourquoi font-ils cela ? Pourquoi ces conceptions populaire de moralité sont-elles déjà si profondément cadrées qu’elles semblent toujours devoir commencer avec ces présuppositions, alors qu’éventuellement, elles s’en écartent ? La meilleure réponse que j’ai pu me faire est que cela a à faire avec des relations de pouvoir. Essentiellement, une chose que l’histoire a révélé encore et toujours est que la moralité de la dette est la manière la plus puissante de faire paraître des relations de pouvoir violentes et arbitraires non seulement morales, mais aussi de donner aux victimes le rôle de pêcheurs et de personnes de fait à blâmer. Les Mafiosi comprennent cela bien entendu, ainsi que les chefs d’armées conquérantes, qui en général annoncent péremptoirement que tout le monde leur doit la vie parce qu’ils ont en fait le pouvoir de les tuer. Cela vous met dans une position où vous pouvez être le bon et les victimes courant partout misérables et se sentant mal à l’aise et mal placées. Cela semble être efficace pour un moment. Le problème est que cela explose périodiquement. Comme l’a fait remarqué Moïse Finley, il semble y avoir un programme révolutionnaire dans toute l’antiquité, qui a annulé la dette et redistribuer la terre, dans cet ordre précis.
La dette semble inspirer le sens à se révolter plus que n’importe quelle autre forme d’inégalité, peut-être parce qu’elle est supposée reposer sur une notion initiale d’égalité. Si vous dites être d’une caste inférieure, vous dites que vous êtes fondamentalement inférieur, ce que les gens n’aiment probablement pas, mais acceptent comme un ordre naturel des choses. Mais si vous refaçonner ça dans le langage de la dette, vous dites en fait “nous aurions du être égaux, mais vous avez foiré quelque part.” Cela semble percuter mieux et la réponse commune que l’on rencontre encore et encore au fil de l’histoire est de dire : “Eh, attendez un peu : qui doit quoi à qui ? Nous faisons votre nourriture, nous vous nourrissons…”
Quelque soit le cadrage, ce que tend à se passer est la seule façon de résister à ce langage de la dette en tant que moralité et de cadrer votre réponse dans le même langage, de telle façon que cela en fait étend la zone à laquelle la dette s’applique. Cela a pour effet que vous reformuliez les relations morales dans le même langage. Vous voyez de nos jours la même chose se produire dans les débats sur la dette du tiers-monde. Qui doit quoi et à qui ? Et c’est exactement ce que les gens finissent par dire : “vous nous devez pour le colonialisme” ; avant de s’en rendre compte, tout ceci s’applique à une multitude de mauvaises actions historiques, dans des zones que vous ne vous seriez jamais attendus à chosifier, comme les dégâts écologiques. La rébellion contre la dette devient incorporée au langage de la dette. Avec ce langage de la dette vient, bien entendu, la logique de l’échange en tout et pour tout, ce qui essentiellement, peut être étiqueté, cadré en termes de marché.
La relation argent, dette, moralité change régulièrement selon les époques, cela dépend de la conception dominante de l’argent, qui dépend elle-même de la forme de monnaie dominante que les gens utilisent à une période donnée de l’histoire. Il semble qu’il y a des glissements réguliers à travers l’Eurasie, du moins entre ce que je j’appellerai des périodes d’argent de crédit virtuel et des périodes d’argent commodité, où les gens utilisent des objets, en général l’or et l’argent, dans chaque transaction et où les gens conçoivent l’argent comme une chose. J’ai été fasciné de constater qu’il n’y a pas de consensus entre les économistes quant à savoir ce que l’argent est de fait. On pourrait bien penser que s’il y avait une chose sur laquelle les économistes pourraient s’accorder, ce serait cela ; mais en fait l’argent est un peu un os pour les économistes. Les écoles dominantes pèsent de tout leur poids derrière l’idée de l’argent comme moyen d’échange ; il y a des arguments tout aussi valides disant que l’argent devrait être considéré comme une unité de compte et que donc les tokens d’argent sont en fait des tokens de dette. De ce point de vue, l’argent est essentiellement une dette qui circule. Des économistes comme Keith Hart argumentent que si vous observez les deux faces d’une pièce, vous y voyez régulièrement la même chose. D’un côté un symbole d’autorité d’État, d’accord et de confiance, l’argent comme relation sociale, qui est le crédit et de l’autre côté se situe le chiffre de l’unité de mesure d’argent, qui implique que l’argent est une chose, une commodité.
Cette tension est toujours là en ce qui concerne la définition de l’argent. J’ajouterais qu’au fil du temps, la définition de l’argent va de l’un à l’autre. Mais, de manière intéressante, l’argent comme crédit virtuel vient en tête. Aussi loin que nous le sachions, si des gens allaient au marché à Sumer, ils n’emmenaient certainement pas quelque chose ressemblant à de l’argent physique. Ils n’avaient pas de pièces de monnaie, ils n’avaient même pas de balance de production. Ils avaient probablement la technologie de le faire, mais ils ne fabriquaient pas de balances suffisamment précises pour peser les tous petits morceaux d’argent qui auraient servi à acheter un cochon, un mouton, un marteau ou une chemise. Il semble qu’alors, toutes les transactions étaient très largement basées sur le crédit. Certaines choses circulaient par achat en argent, certains grains etc mais tout était basé essentiellement sur une économie de crédit, ce qui rendait possible d’annuler de la dette, ce qui est bien plus difficile à faire en période d’argent commodité. La période où fut inventé l’argent dit “liquide” correspond aussi à la période fameusement nommée par Carl Jaspers “L’âge axial”, durant lequel on voit aussi l’émergence de nombreuses philosophies dans le monde et les majeures religions, exactement dans les mêmes endroits où l’argent fut créé : en Méditerranée orientale, dans les vallées du Gange en Inde et dans les plaines du nord de la Chine.
Il semble que la fabrication de pièce de monnaie soit très largement un effet secondaire de la technologie militaire, qui est très liée aux systèmes de taxation. L’or et l’argent sont bien les sortes de choses que les soldats habitués au pillage vont transporter d’un endroit à l’autre. Des soldats itinérants et lourdement armés sont sans doute les dernières personnes à qui vous feriez, en tant que commerçant local, crédit. Mais ils ont de l’or et de l’argent. Eventuellement, après une période où les marchands et les soldats commercent en or et en argent, l’État s’en mêle et découvre que la meilleure façon de contrôler les troupes est de leur donner systématiquement de petites portions de ces métaux précieux et de dire à tout le monde sous votre coupe de rendre ces pièces. D’un seul coup, vous vous louez les services de tout le monde dans votre royaume pour entretenir les troupes.
Cela marcha très très bien. La chose fascinante au sujet de cet âge axial est que vous avez des armées, que l’argent à tendance à suivre les armées constituées. Vous avez aussi la montée en puissance des religions du monde, qui dans presque tous les cas, nient une partie de la logique morale de ces marchés d’argent comptant impersonnels qui sont permis par l’argent commodité, ainsi donc l’idée de charité semble jaillir presque simultanément C’est comme si vous disiez : “créons donc cet espace où nous aurons cette chose appelée intérêt particulier…” et si nous essayons d’obtenir le plus de choses matérielles pour nous-mêmes, quelqu’un va venir et dire “bon, et bien ici nous aurons un espace où nous pensons pourquoi les choses matériels ne sont pas importantes ; c’est mieux de donner que de recevoir.” Ceci se passe régulièrement dans chaque endroit.
La chose la plus extraordinaire, c’est que tout cela se coordonne vraiment bien à travers toute l’Eurasie. Au Moyen-Age, ces empires ont atteint leur apogée et ils s’effondrent. Avec la disparition des armées en campagne et de l’esclavage privée, la frappe de monnaie disparaît dans les grandes largeurs, mais au lieu de revenir au troc, les gens en fait retourne aux systèmes de crédit. Ces systèmes de crédit sont essentiellement contrôlés par les systèmes moraux et religieux qui se sont levés en opposition au monde de la transaction en argent physique intrinsèquement identifiée au militarisme et l’état d’avant. Avec cela vint l’interdiction de l’usure, qui n’existait pas du tout dans le vieux monde. Il semble que dans les période où on conçoit l’argent comme une relation sociale, un système de conventions sociales, la définition d’Aristote encore, ne fut pas largement adoptée dans l’antiquité mais au moyen-âge, il devient possible de faire certaines choses comme pratiquées dans le monde ancien : annulation des dettes dans l’islam et le christianisme médiévaux, ou interdictions de l’usure, ce qui est bien plus difficile à faire dans des périodes où on considère l’argent comme une chose, une commodité.
Malgré le fait que les constitutions athénienne et romaine furent créées essentiellement en réaction aux crises de la dette, les anciennes économies ne se sont jamais résolues à des annulations totales de la dette. Au lieu de cela, elles mirent en place des politiques de redistribution dans lesquelles elles jetèrent de l’argent à la face du problème et donc frapper la monnaie devient une sorte de technologie morale. Par exemple, dans l’Athènes antique, les gens étaient payés pour aller à l’Agora et pour voter. Il y a tous ces mécanismes de redistribution de l’argent par le truchement de moyens politiques ainsi les gens ne tombaient pas dans la dette profonde au point de devenir les esclaves des riches et ainsi donc risquer de détruire la base militaire de l’État.
Dès 1450 et avant même la découverte ibérique des Amériques, l’argent commodité retourne sous la forme de lingots et avec cela renaissent de larges empires, des armées de conquêtes, l’esclavage personnel, qui réapparaît sous une forme altérée. J’argumenterais que cette période est celle dont nous venons à peine de sortir maintenant, mais de manière très lente et sporadique. Le point standard de rupture est l’année 1971, quand Nixon a sorti définitivement le dollar américain du standard or.

Il est intéressant de noter que l’interdiction de l’usure qui fut maintenue pendant le moyen-âge fut graduellement érodée. J’ai toujours pensé qu’une des raisons du pourquoi l’église a été si véhémentement opposée à l’usure par rapport à d’autres éléments du capitalisme émergent, c’est parce que la moralité de la dette était si puissante, que l’église pouvait reconnaître un rival quand elle en voyait un. Le fait est que la dette est le meilleur moyen de transformer les gens en des acteurs utilitaires rationnels, comme les économistes aiment à l’imaginer, où on a peu de choix que de voir simplement le monde en termes de sources possibles de profit et de danger. Une des choses qui m’a le plus fasciné fut de regarder les histoires de quelques personnes qui se comportèrent de la manière d’acquisition irrationnelle la plus bizarre que vous puissiez imaginer, devenant des paradigmes de l’insatiabilité des êtres humains : les conquistadores par exemple.
Ceux-ci étaient submergés par la dette. Ils commencèrent dans la dette et ne s’en échappèrent jamais vraiment. Une des raisons pour laquelle ils recherchaient toujours de nouveaux royaumes était parce que, même après la conquête du royaume Aztèque, Cortez se retrouva de nouveau dans la dette 15 ans plus tard et il commença à repartir sur le chemin de la conquête. Tous ces hommes étaient endettés jusqu’au cou et devaient faire ce qui était nécessaire pour acquérir de l’or, commettant au passage d’énormes atrocités pour repayer leurs dettes.
Ce genre de manipulation de la dette comme forme de moralité en lui-même fut lancé et devint “naturel”, quand vous pensez à l’argent comme une chose naturelle : comme un objet plutôt qu’une création sociale. En tant que technologie morale, l’argent permet à certains types de moralité d’émerger, ceux-ci étant très puissants. Les gens de pouvoir qui ont originellement découvert le pouvoir de la moralité de la dette il y a si longtemps, ne veulent pas les abandonner. Un des grands mystères est que lorsque vous avez des périodes de crédit d’argent virtuel, que ce soit dans la Mésopotamie antique ou au moyen-âge, vous voyez des gens qui créent des moyens de s’assurer que ceux qui ont le pouvoir de créer du crédit ne terminent pas à réduire les autres en esclavage. Cela se produit encore et encore et prend différentes formes, d’où les annulations de dette périodiques dans la Mésopotamie ancienne, les célèbres jubilées dans la Judée antique et les lois variées sur l’usure. Vous trouvez que tout cela était en combinaison avec la promulgation par les bouddhistes des monts de piété et autres alternatives afin d’empêcher les prêts à haut taux d’intérêt. La première utilisation des monts de piété fut en fait une affaire religieuse (NdT ; d’où le nom en français, en anglais cela se dit “pawn shop”, ce qui n’a rien à voir..) mise en place par des moines bouddhistes en Chine puis, plus tard, par les moines dominicains en Europe, de manière indépendante présumée.
Il y a tous ces mécanismes créés pour protéger les endettés en période d’argent crédit virtuel. Où sont nos versions de ces mécanismes ? D’accord, nous ne sommes que 40 ans environ dans ce système. Ceci n’est pas très long de par les standards auxquels nous nous référons, souvent des cycles de 500 à 1000 ans. Mais nous avons fait exactement l’opposé. Ce que nous avons fini par créer, ce sont des institutions comme le FMI ou Standard & Poor’s c’est à dire des institutions faites pour protéger les créditeurs contre les endettés. Sans surprise, le résultat de ces 40 premières années a été toute une série de crises de la dette. Considérez la dette du tiers-monde, qui a mené à des formes de résistance particulièrement efficace, d’abord en Extrême-Orient, puis en Amérique Latine, d’où le FMI a quasiment été viré. Ces crises de la dette sont continues, elles augmentent, elles semblent réunir la tendance historique pour une économie basée sur l’argent crédit.
Voilà pourquoi j’insiste sur le pouvoir de l’argent comme moralité. Je pense qu’il y a une contradiction entre les intérêts du système sur le long terme et ces mécanismes idéologiques qui sembleraient vouloir le légitimer. La moralité de la dette et la moralité du travail semblent être les deux zones dans lesquelles les vertus capitalistes, les vertus du système économique, sont profondément inculquées dans la conscience populaire et très largement acceptées. Questionner cela, ouvre les portes dont je pense que beaucoup de personnes ont peur d’ouvrir, malgré le fait qu’à ce point, l’annulation de la dette semble quasiment inévitable.
La raison pour laquelle je dit “quasiment” est parce qu’il y a une telle résistance. Elle est remarquable. C’est tellement clairement dans l’intérêt de la classe dirigeante de commencer à annuler de la dette sur une grande échelle. La Réserve Fédérale a grandement essayé de voir la dette sur les emprunts fonciers annulée et ils n’ont pas avancé depuis l’an dernier (2013) Qu’est-ce qui le retient ? Cela doit être un attachement à cette idée morale fondamentale, parce qu’il n’y a plus beaucoup de soutien moral du système qui soit.
L’une d’entre elles est la valeur morale du travail. Keynes avait prédit que dès maintenant, nous pourrions bien avoir une journée de travail de 4 heures si nous le voulions et nous pourrions remarquer “Et bien visiblement nous ne le voulons pas, mais cela montre de manière évidente que plutôt que d’être heureux avec les biens que nous avons, cela a quelque chose à voir avec le désir, avec cette pulsion de la consommation.”
Je pense que ce n’est absolument pas vrai. Si vous regardez ce que font les gens pendant une journée, ils ne font pas grand chose qui contribue à la production de produits de consommation. En fait, un phénomène inexploré en Amérique aujourd’hui est le fait de combien de personnes sont secrètement convaincues qu’ils ne font pas vraiment grand chose de la journée, que leur boulot est complètement inutile et n’a aucune valeur et ne devrait probablement pas exister. Je rencontre des gens comme ça tout le temps. Je connais tant de personnes qui en sont au bout du rouleau professionnellement et ne savent pas quoi faire, qui ont été en fac de droit et qui sont maintenant des avocats d’affaire pour des entreprises, je n’en ai pas rencontré un qui n’admettrait pas, du mois avec quelques verres dans le nez que “ce boulot est complètement inutile et stupide et ne devrait pas exister.” Vous pouvez faire beaucoup d’argent à faire ce boulot et aucun en étant un poète, ou autre chose. Cela vous dit quelque chose d’intéressant sur ce qu’on appelle “le marché” : il semble qu’il y ait très peu de demande pour des poètes ou des musiciens de talent, mais une demande quasi infinie pour des avocats d’affaire…
Je pense que nous devons penser cela en termes moraux. Pensez aux gens qui travaillent 4 heures par jour. Vous savez qu’il y a une foule de gens qui vont au travail tous les jours, s’assoient 8 heures mais ne font de fait que peut-être 3 ou 4 heures de travail effectif durant cette vacation. Le reste du temps, ils sont maintenant sur Facebook, ils tweetent, téléchargent du porno ou quoi que ce soit d’autre. Je parle à une quantité de gens et un grand nombre me dit : “En fait, je fais 2 ou 3 heures de travail productif dans la journée.” En fait, nous travaillons 4 heures par jour, mais à cause de cette moralité profonde attachée au travail, nous ne voulons pas en fait l’admettre.

Tout le pouvoir aux ronds-points !…
Nous voudrions penser à un parallèle avec l’Union Soviétique. Je pense vraiment que le système soviétique était basé sur une contradiction fondamentale du fait qu’il a hérité d’une consistance essentiellement anarchiste (NdT : ne pas oublier que le premier “soviet” qui veut dire “assemblée populaire” en russe a été créé à St Petersbourg en 1905 par des anarchistes. Le concept de “soviet” est anarchiste par essence, il a été spolié plus tard par les marxistes autoritaires d’état en mission pour la City de Londres et sa succursale de Wall Street dont Lénine et Trotsky étaient les agents à succès…) et d’une idéologie marxiste. Pendant les années 1920 et 1930, on nota souvent la différence entre les syndicats anarcho-syndicalistes et les syndicats socialistes dans le fait que les anarchistes demandaient toujours une réduction des heures de travail et les socialistes une hausse des salaires. Essentiellement, ce furent les socialistes qui amenèrent le système productiviste et consumériste. Les anarchistes voulaient juste en sortir : “Nous ne voulons rien à voir à faire avec ça. Nous voulons travailler le moins possible.” Il y eut un célèbre débat entre Marx et Bakounine au sujet d’où la révolution viendrait-elle ? Serait-ce en provenance du prolétariat allemand plus avancé ? “Non, non, ce sera en provenance des paysans et artisans récemment prolétarisés en Russie et en Espagne”, dit alors Bakounine, l’avenir lui donna raison. Donc ces entités anarchistes qui voulaient moins d’heures de travail ont fini par créer des révolutions qui finirent absorbées par une élite marxiste-productiviste affirmant vouloir mettre en place une société de consommation, mais en étant incapable. Mais un des bénéfices de leur système fut qu’on ne pouvait pas être viré de son travail, donc les gens travaillaient de fait 4 heures par jour, à vie.
La grande contradiction en ce qui me concerne de ces systèmes, fut qu’ils ne purent reconnaître ou prendre la responsabilité du bénéfice social qu’ils donnèrent au public, à savoir la sécurité de l’emploi dans une journée de travail de 4 heures par jour. Si vous y pensez bien, passer d’une économie arriérée à lancer des satellites en orbite sur la base d’une journée de travail effectif de 4 heures par jour est assez impressionnant. Mais ils ne pouvaient pas admettre ce qu’ils donnaient aux gens. Tout le monde prétendait travailler 8 heures par jour, mais en fait ne travaillait que 4. (NdT : surtout dans une société bureaucrate où des boulots de gratte et pousse papiers / dossiers numériques sont légions, pas seulement dans les pays “socialistes”, mais partout aujourd’hui dans le monde occidental…)
Il semble que nos sociétés ressemblent à ça de plus en plus et tant de boulots sont dénués de sens ou de buts, mais là encore les gens se sentent obligés de le faire pour des raisons morales ou idéologiques, de le faire encore et encore. Je pense que beaucoup de la politique peut être expliqué de la sorte. J’ai toujours argumenté pour dire qu’une grande partie du populisme de droite est fondé sur le ressentiment des gens qui ont des boulots insensés. L’élite culturelle est vue comme ces gens qui monopolisent ces boulots où vous pouvez être payées pour faire quelque chose qui n’est pas juste pour un salaire. Comment tous ces salopards osent-ils prendre tous les boulots altruistes ?
Dans la même veine, je trouve fascinant ce ressentiment contre les ouvriers de l’automobile ou les enseignants. Je pense que cela peut être expliqué en ces termes moraux, il semble qu’il y ait un sens pour les gens à dire :”Quoi ? Vous les mecs faites quelque chose de réel. Vous enseignez aux enfants, vous fabriquez des voitures, vous voulez aussi des bénéfices ?” Il est important à mon sens que nous repensions en quoi le type de moralité que l’argent permet, à la fois en termes de dette et de travail, devient une force politique en elle-même et que bon nombre de ces problèmes que nous concevons être des problèmes économiques ne sont en fait que des problèmes politiques déguisés.
(NdT : donc de “pouvoir”, nous ramenant à la seconde citation de Clastres que nous avons mis en début de texte et nous rajouterions celle-ci du même Pierre Clastres :
“La relation politique de pouvoir précède et fonde la relation économique d’exploitation. Avant d’être économique, l’aliénation est politique, le pouvoir est avant le travail, l’économique est une dérive du politique, l’émergence de l’État détermine l’apparition des classes.”
~ Pierre Clastres, directeur de recherche en anthropologie politique au CNRS, 1974 ~ )
Le texte en PDF : David_Graeber_La-signification-de-largent
-[]-
David Graeber sur Résistance 71
“Les historiens et les économistes aux gages de l’État nous ont enseigné, sans doute, que la commune de village, étant devenue une forme surannée de la possession du sol, forme qui entravait les progrès de l’agriculture, dut disparaître sous l’action des forces économiques naturelles. Les politiciens et les économistes bourgeois ne cessent de le répéter jusqu’à nos jours ; et il y a même des révolutionnaires et des socialistes — ceux qui prétendent être scientifiques — qui récitent cette fable convenue, apprise à l’école.
Eh bien, jamais mensonge plus odieux n’a été affirmé dans la science. Mensonge voulu, car l’histoire fourmille de documents pour prouver à qui veut les connaître — pour la France, il suffirait presque de consulter Dalloz — que la commune de village fut d’abord privée par l’Etat de toutes ses attributions ; de son indépendance, de son pouvoir juridique et législatif ; et qu’ensuite ses terres furent, ou bien tout bonnement volées par les riches sous la protection de l’Etat, ou bien directement confisquées par l’Etat…”
~ Pierre Kropotkine ~
“L’état n’est pas quelque chose qui peut être détruit par une révolution, mais il est un conditionnement, une certaine relation entre les êtres humains un mode de comportement humain, nous le détruisons en contractant d’autres relations, en nous comportant différemment.”
~ Gustav Landauer ~
= = =
Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)
Comprendre et transformer sa réalité, le texte:
Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »
+
5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:
Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être
Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche
Manifeste pour la Société des Sociétés
Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie
Société des sociétés organique avec Gustav Landauer