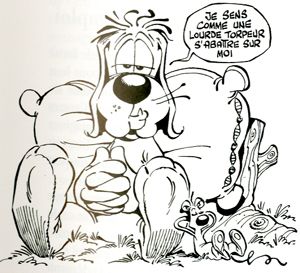De l’autre côté du miroir
Réflexions sur les médias
Salto subversion & anarchie
2013
« Je ne sais pas ce que vous entendez par “gloire” », dit Alice. Humpty Dumpty sourit d’un air méprisant : « Bien sûr que vous ne le savez pas, puisque je ne vous l’ai pas encore expliqué. J’entendais par là : “Voilà pour vous un bel argument sans réplique !” » « Mais “gloire” ne signifie pas “bel argument sans réplique” », objecta Alice. « Lorsque moi j’emploie un mot, répliqua Humpty Dumpty d’un ton de voix quelque peu dédaigneux, il signifie exactement ce qu’il me plaît qu’il signifie, ni plus, ni moins. » « La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu’ils veulent dire. » « La question, riposta Humpty Dumpty, est de savoir qui est le maître… C’est tout. » (Lewis Carroll, De l’autre côté du miroir.)
En Europe, l’État moderne a hérité, en le sécularisant et en l’adaptant aux besoins du capitalisme, du mode de représentation spécifique au christianisme. La démocratie avec les institutions et les formes de représentation qui l’accompagnent et qui la sanctifient – dont les médias sont l’une des pièces maîtresses -, est véritablement le ciel idéalisé du monde terrestre du capital. Elle rappelle, par bien des côtés, l’univers chrétien avec ses fidèles, ses rites, sa hiérarchie ecclésiastique et même ses hérétiques. Les citoyens continuent, sous des costumes profanes, à se comporter en partie comme des chrétiens. Ils protestent parfois contre les abus des ministres terrestres du dieu démocratique et contre la fourberie des interprètes de sa parole, à l’occasion de façon impertinente, en les insultant, en les chassant et parfois en les rossant. Il leur arrive même de refuser de participer aux cérémonies présidant au choix et à l’intronisation de leurs élus par l’intermédiaire des élections – encore le jargon religieux ! Mais ils ne vont pas jusqu’à briser l’idole et à rejeter en totalité le système global de représentation qui l’enveloppe. Là, ils restent paralysés, comme frappés de terreur sacrée face à l’ampleur du sacrilège. Malgré leurs poussées de colère et de méfiance, ils continuent à y croire et à l’accepter pour autant qu’il prenne des apparences plus aimables, fasse mine d’écouter leurs doléances et de les rapporter aux représentants du peuple souverain. Et nombre de contestataires qui crachent sur la mise en spectacle de la réalité effectuée par l’institution étatique n’hésitent pourtant pas à céder aux appels de pied des médias, voire à les solliciter.
Il est donc impossible d’en rester à la stigmatisation des médias pour leurs omissions, leurs déformations, leurs falsifications, leurs calomnies, leur rôle de relais de la police, etc. Sinon, la rupture avec les bases même de l’État, telles qu’elles furent constituées à l’époque de la prise du pouvoir par la bourgeoisie, reste incomplète. Car les illusions sur la possibilité d’utiliser les médias sont la conséquence et la consécration de celles, concomitantes à la création et à la consolidation de l’État démocratique, sur la possibilité de prendre part aux assemblées souveraines, en premier lieu l’assemblée parlementaire, dans l’objectif de les transformer en tribunes de diffusion des idées subversives. L’auréole qui entourait, au lendemain de la Commune de Paris, la représentation parlementaire devait finalement, vu la multiplication des dispositifs et des médiations mis en place dans tous les domaines de la vie sociale, et vu la résorption relative de la politique dans l’économie et dans le social, être élargie à la représentation en général, au fur et à mesure que le capital labourait et domestiquait l’ensemble de la société.
C’est ainsi que le spectacle de la politique, désormais bien décrépi, est devenu le spectacle du monde par l’intermédiaire des médias, la culture jouant ici le rôle de l’une des prothèses essentielles de la politique. Par suite, quasi personne ne pense plus à participer aux élections (nationales ou communales) dans l’objectif de les retourner pour en faire des tribunes et pour en faciliter le dynamitage en cas d’insurrection. Par contre, l’argumentation de type léniniste, employée hier pour justifier la participation à la tribune parlementaire, est reprise presque à l’identique aujourd’hui pour affirmer que les révolutionnaires peuvent utiliser, à l’occasion, les tribunes que représenteraient les médias pour communiquer leurs idées – la communication est la transcription du terme désormais suspect de propagande. Bien entendu, face aux réticences que génèrent leur « subtile » tactique, à peu près aussi « subtile » que le parlementarisme des partis communistes d’antan, les adeptes de la dissidence journalistique déposent les mêmes bémols sur la même partition usée jusqu’à la corde, avec des promesses solennelles du genre : « L’utilisation des médias ne sera pas le nombril de notre activité. » Mais, dès que l’on a mis le pouce dans les engrenages de la représentation, il est difficile de l’en retirer et il n’est pas rare que, peu à peu, le corps y passe en entier, tête comprise. Dans Humain, trop humain, Nietzsche a bien résumé le processus amenant les individus, qui croient possible de jouer au plus malin avec la domination sans disposer du pouvoir réel, à en devenir de vulgaires partisans :
« À force de croire pouvoir endosser sans conséquences les rôles les plus divers, l’individu change peu à peu. À la fin, il n’est plus que ce qu’il croyait paraître. »
De même, l’antique préjugé religieux sur la toute-puissance attribuée au verbe est loin d’être dépassé, préjugé qui, hier encore, justifiait que les partis léninistes créent des fractions parlementaires, qui ne devaient pas participer aux commissions parlementaires et jouer seulement le rôle de tribuns du haut de leur perchoir. L’histoire du parlementarisme révolutionnaire a montré que les prétendus propagandistes étaient devenus, en règle générale et à bref délai, des députés au sens le plus habituel du terme, leur phraséologie révolutionnaire camouflant leur activité de gestionnaires de l’État. De même aujourd’hui, on imagine parfois pouvoir faire irruption sur le terrain de la représentation médiatique pour le labourer, en quelque sorte, avec le langage de la subversion. Mais ce n’est que dans la mythologie biblique que les trompettes détruisirent les murailles de Jéricho. De telles conceptions, qui accordent des vertus quasi magiques au verbe révolutionnaire, pouvaient faire encore illusion lorsque le système de représentation officiel du capitalisme le traitait en permanence en ennemi, le censurait, l’ignorait, etc. Mais l’histoire des poussées révolutionnaires, en particulier celles des années 1960-1970 et de leurs échecs successifs, est passée par là. Leurs caractéristiques inédites, entre autres leur critique embryonnaire de la séparation politique et du rôle de laquais du pouvoir d’État joué par les médias institutionnels ont affecté en profondeur le système de représentation contemporain. Loin d’être la simple conséquence de l’évolution propre du capital, il est aussi l’exécuteur testamentaire des illusions de ces révoltes, en particulier de la tendance à charger le langage de plus de potentialités subversives qu’il ne peut en avoir. L’État démocratique a pu ainsi effectuer la neutralisation des idées qu’elles portaient plutôt que les interdire.
Désormais, le fossé est pour l’essentiel comblé. Lorsque des formes d’expression hostiles à la société semblent prendre de la vigueur et acquérir quelque influence hors des sentiers balisés, les pires ennemis ne sont plus les censeurs, mais les récupérateurs et les experts en reconnaissance sociale et étatique, des journalistes aux sociologues. La démocratie fonctionne ainsi : les choses qu’elle ne peut pas ignorer, elle les reconnaît pour mieux les réduire à rien en les vidant de leur sens. Pour les irréductibles qui refusent de jouer le jeu, il reste évidemment la coercition. Mais plus les oppositions que l’État arrive à séduire paraissent subversives, plus le système de représentation y gagne. L’essentiel est qu’elles ne dé- bouchent pas sur quelque tentative de transformation du monde. En la matière, le rôle des médias est déterminant. Il y a longtemps qu’elles ne se contentent plus de dépeindre sous des couleurs chatoyantes le monde capitaliste et de stigmatiser en bloc n’importe quelle tentative de le remettre en cause. Bien que le mensonge, en particulier le mensonge par omission, reste nécessaire, la domination actuelle est capable d’absorber sans crises majeures l’étalage des horreurs qui accompagnent son cours. Même la contestation peut parfois devenir marchandise, en particulier lorsqu’elle évolue sur le terrain politique et culturel. Là aussi, la récupération du refus embryonnaire de la politique, qui avait cours dans les années 1960-1970, a été décisive. La politique dite révolutionnaire est devenue objet de représentation officielle, après avoir perdu son sel réellement révolutionnaire. Les médias y gagnent la faculté de représenter de façon réifiée les révoltes, de purger les passions de ce qu’elles peuvent avoir de subversif, de transformer les rêves et les tentatives de bouleverser le monde en d’inoffensives rêvasseries qui ne changent rien à la vie de ceux qui participent au spectacle de la consolation citoyenne. Les médias ont en fait des informations au même titre que le reste, des masses de données à sélectionner, à traiter et à régurgiter aux spectateurs désabusés par le spectacle quotidien du monde, qui va de crises en catastrophes, mais toujours à la recherche de nouvelles drogues médiatiques, aussi excitantes qu’éphémères. Ainsi tourne le monde de la marchandise la plus moderne.
Face à la désaffection envers la politique et à la dégénérescence des partis en clans occupés à gérer les affaires courantes, l’État a reconnu qu’il ne pouvait plus régenter la société seulement par les moyens habituels : par la coercition sans phrases et la gestion administrative des populations. Il y a là des fissures peut-être pleines de risques qui apparaissent et le pouvoir d’État a horreur du vide. C’est pourquoi l’heure est au serrage de vis, mais aussi à la participation de tous au spectacle qu’offre la démocratie. La censure existe toujours par intermittence, mais c’est essentiellement l’autocensure qui domine. La domination moderne ne peut se maintenir par le biais de la seule contrainte imposée comme telle et sans faire participer ceux et celles qu’elle écrase, à des degrés divers, au maintien de leur propre subordination. Elle favorise donc la mise en place des médiations destinées à encadrer et à neutraliser les tentatives de contestation embryonnaires, tels les colloques, les discutions contradictoires et les consultations, relayés par les médias et parfois organisés avec eux, voire par eux, dans lesquels les associations de citoyens sont invitées à débattre et à donner leur avis sur les « questions de société », déjà tranchées pour l’essentiel dans les coulisses du pouvoir d’État, afin de participer à la cogestion de leur aliénation. Les médias, même les plus contestataires d’entre eux, constituent donc des pièces maîtresses du dispositif de neutralisation en cours d’institutionnalisation. Ils jouent le rôle de relais de l’État pour combler les vides générés par l’atomisation de la vie quotidienne, pour « resocialiser les citoyens » et leur « redonner goût à la politique », comme l’affirment les sociologues. En d’autres termes, les médias participent pleinement au processus de sélection et de reconnaissance par l’État de leaders, d’associations, de lobbys, etc., qui sont censés représenter les forces d’opposition qui agitent la prétendue société civile. Au point que, contrairement à ce qui arrivait à l’époque de la reconnaissance par l’État des associations syndicales, il suffit aujourd’hui que telle ou telle vedette de la contestation soit reconnue par les médias comme interlocuteur pour que l’on dise d’elle qu’elle est représentative. Sans même savoir de qui et de quoi. Les médias donnent ainsi quelque apparence de force à des choses qui, parfois, en ont peu, ou pas du tout.
Dans de telles conditions, l’idée d’utiliser à l’avantage des révolutionnaires les niches médiatiques que le pouvoir leur concède n’est pas seulement illusoire. Elle est franchement dangereuse. Leur seule présence sur les plateaux ne suffit à fissurer le carcan de l’idéologie dans la tête des spectateurs. À moins de confondre puissance d’expression et puissance de transformation et à croire que le sens de ce que l’on exprime, par la parole, par la plume, par l’image, etc., est donné a priori, sans avoir à se préoccuper de savoir qui a le pouvoir de le faire. Il y aurait là du contenu qui pourrait exister sous des formes diverses sans en être affecté. Vieille illusion du monde réifié dans lequel les activités apparaissent comme des choses en soi détachées de la société. Mais pas plus que d’autres formes d’expression, la forme subversive du langage est la garante de l’incorruptibilité du sens. Elle n’est pas immunisée contre les dangers de la communication. Il suffit de l’exprimer sur les terrains propres à la domination pour en miner la signification, voire pour l’inverser.
C’est très exactement ce qui arrive sur le terrain des médias, lorsque l’on accepte d’y intervenir, même de façon insolente. Séparées de l’ensemble des conditions qui participaient à leur donner leur sens, les idées contestataires, même lorsque les médias n’y changent pas la moindre virgule, n’apparaissent plus que comme des opinions balancées sur le marché médiatique des idées, comme des interprétations du monde, voire des interprétations de la transformation du monde, parmi d’autres, bref des prises de position sans conséquences réelles. Au fond, il arrive ici, par exemple dans les tables rondes, ce qui est déjà advenu à l’époque de la naissance du parlementarisme. Des députés d’opposition prononçaient même parfois dans l’hémicycle des discours incendiaires qui les conduisaient en prison. Pourtant, en acceptant d’intervenir sur le terrain de la représentation politique, dont la clé de voûte était alors la Chambre des députés, ils apportaient de l’eau au moulin de la domination. À l’origine, ils pensaient sans doute diffuser leurs discours révolutionnaires en direction des populations qui, pétries d’illusions démocratiques, étaient à l’écoute de ce qui était débattu dans l’enceinte parlementaire. En réalité, ils étaient en train de passer de l’autre côté du miroir et commençaient à dialoguer avec le pouvoir d’État. Rien d’étonnant qu’ils aient fini, en règle générale, par y participer, voire par en prendre la direction. Car le spectacle n’est pas réductible à des ensembles d’images, mais il constitue le système de représentation dominant, intégré aux rapports sociaux entre des personnes, médiatisés par des images, rapports propres à la domination du capital. Partie intégrante de la domination, les médias participent également à l’instrumentalisation des relations sociales.
Avec l’introduction et la généralisation des nouveaux médias digitaux comme Internet, l’utilisation des « vieux » médias à des fins « subversives » semble laisser la place à l’intégration de toute une génération d’activistes, voire de révolutionnaires et d’anarchistes, dans les sphères virtuelles. Même quand ils identifient ces médias et leurs corollaires « participatifs » et « sociaux » comme des instruments de la domination, ils croient pouvoir en faire un usage qui nuirait à cette nouvelle forme de production de la pacification sociale. Mais le contenu cède rapidement la place aux exigences inhérentes à ces instruments et à toute la technologie de communication : rapidité, compatibilité avec l’ensemble, réductionnisme, reconnaissance par et dans le spectacle virtuel, efficacité. La subversion dans la pensée et dans les actes ne peut être imaginée que comme un mouvement de libération de telles caractéristiques. La représentation dans le monde virtuel suit la même ligne logique qui va de l’assemblée parlementaire aux médias : elle suscite l’illusion de combler la lacune entre les discours révolutionnaires et les véritables poussées subversives et reculs dans les rapports sociaux. Ce qui peut être représenté, ne saurait longtemps résister à l’intégration dans la gestion moderne de l’ordre.
Les spectateurs, même les plus informés, n’en restent pas moins des spectateurs. Il règne entre eux le silence ou le rabâchage des clichés aussi protéiformes que banals qui correspondent aux rapports entre marchandises. Ils restent isolés ensemble. Toutes les formes de langage leur sont alors étrangères et s’autonomisent comme discours du pouvoir. Le spectacle est l’inverse du dialogue, de la rencontre et de la recherche d’affinités pour combattre le système qui nous sépare et nous traite comme des objets manipulables à volonté. Refusons donc des formes d’instrumentalisation, telles que la participation au spectacle médiatique, et traitons-les comme elles le méritent : en ennemies. N’oublions jamais que, séparés de l’activité subversive, les modes d’expression, aussi subversifs qu’ils puissent paraître, finissent par perdre leur saveur. À nous de mettre en œuvre nos modes de dialogue, par la plume et par d’autres moyens qui nous sont propres.
= = =
Lectures complémentaires:
Manifeste pour la Société des Sociétés
petit_precis_sur_la_societe_et_letat
Appel au Socialisme Gustav Landauer
le bouclier du lanceur d’alerte